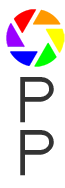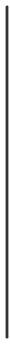L’observatoire mis en récit... par Estelle-Sarah BULLE
Point de vue n°17 : Place du monument aux morts, Goyave
(ce point de vue est également commenté par Sylvain Duffard, photographe, et Jean-Christophe Robin, urbaniste)
La Guadeloupe est un point sensible où l’on sent la Terre tourner. Le ciel y est en gestation. La matière de l’île, sulfureuse, ouatée de scories noires et rouges, éclot en permanence, mouillée puis remodelée. La mer a des bouillonnements laiteux, la falaise s’arase et les montagnes suent. Un perpétuel remuement de chaudron épuise l’herbe fragile et fait monter très vite les arbres jusqu’à leur point de rupture.
Et il y a les pentes difficiles de la Basse Terre, couvertes de tuf humide, où l’on ne s’accroche qu’à condition de faire preuve de légèreté et de connivence avec la nature. On les devine à l’arrière-plan de la photo ces degrés raides : collines parées d’arbres qui résistent en se renouvelant souvent plutôt qu’en misant sur une maturation lente, trop sujette aux dangereuses secousses et aux dévalements des eaux.
Pour habiter au milieu de cette instabilité, les Guadeloupéens ont dû prendre l’éphémère comme point de départ. Ils construisent dans l’urgence ce qui sera détruit demain, happent ce que les bateaux pressés charroient jusqu’à leurs rives déchiquetées, pensent abri plutôt que maison, contre les pluies lourdes et les tempêtes sablées.
Dans cette rue de Goyave, si semblable à d’autres ruelles fragiles de l’île, les matériaux s’étagent et se disloquent, comme le paysage. Le bitume se crevasse, la faïence écaille un trottoir patiné par les pas et la chaleur, la peinture se dissipe en lambeaux poudreux sur les arches de bois usées.
Et puis il y a la tôle. Rougie, onduleuse, dentelée par l’eau et le sel. Matériau du pauvre et de la hâte, elle est présente dans toute l’île.
Petite, je cohabitais avec les grandes plaques de tôle abandonnées sur le terrain de mon grandpère (on ne disait jamais "jardin"), à moitié recouvertes par la végétation, destinées à un hypothétique projet de "magasin" ou d’abri à cochon. Leurs bords écornés, rebiquant méchamment vers le ciel, restaient, même après des mois d’érosion, aussi coupants que la feuille de canne. Je me méfiais d’elles comme de caïmans à l’affût, prêts à mordre dans la chair tendre de mes mollets dénudés.
Un jour qu’au milieu des poules, je forçais à la fuite une mangouste au corps souple, ma mère m’appela depuis la terrasse de la maison. J’oubliai le danger de la tôle sous l’herbe brune et j’en fus punie. Mon pied transpercé poissa de sang ma sandale qui perdit définitivement sa couleur d’origine. Assise chancelante sur le bord de la terrasse, je n’osais pas regarder en face les lèvres obscènes de la blessure, couleur de litchi. J’envisageai tout de suite, le coeur battant, une maladie de rouille mortelle. On versa sur mon pied le rhum clair, bienfaisant. Je m’en tirai avec une simple entaille profonde.
Des semaines plus tard, après une nuit passée à écouter, recueillie, les coups de poing d’un robuste cyclône, j’ouvris la porte de mon grand-père sur un matin nouveau. Quelque chose avait changé autour de la maison. Les feuilles de tôles, qui semblaient enchâssées pour l’éternité dans la terre spongieuse, couvertes d’herbe à zébu et de manmzelle marie, avaient disparu. Levant les yeux, je les retrouvai hautes et nues dans le cocotier que le cyclone s’était amusé à garnir de ces papillotes métalliques.
La tôle, c’est aussi le toit des cases ; piano diabolique pour les doigts impérieux des pluies chaudes et félines. J’aimais l’écho assourdissant de ces rhapsodies folles au-dessus de ma tête. Une averse solide sur le toit interrompait toutes les conversations, étouffait les disputes les plus sonores, ramenait les voix de stentor au niveau d’un bêlement de cabri nouveau-né. Le paysage, aperçu depuis l’intérieur de la case restée ouverte, blanchissait jusqu’à disparaître derrière l’épais rideau de pluie. L’ondée musicienne s’en allait aussi rapidement qu’elle était venue. Le silence autour de la case ouverte revenait, perlé par les dernières notes sonores des gouttes dégringolant jusque dans les fûts de tôle qui servaient de citerne à côté de la cuisine. Sous ces lourds tonneaux cloutés prospéraient des dizaines de petites grenouilles siffleuses aux doigts délicatement lobés et des anolis pointus, d’un vert de tige fraîche.
Les jours de grande chaleur, petite vacancière désoeuvrée, tandis que mon grand-père était aux champs, je passais l’après-midi, hébétée et rêveuse, à déchiffrer le craquement rythmé des murs et du toit de tôle, dilatés par le soleil.
Inventée en Allemagne, aussitôt adoptée par la pragmatique Angleterre, la tôle ondulée a vite conquis sa place dans les terres coloniales, de l’Australie à l’Afrique. Matériau pour populations soumises, pour habitats de misère dont les Gouvernements ne se soucient pas de la durée, elle a pourtant duré. La tôle s’est acclimatée partout, spécialement aux Caraïbes.
Dans cette rue de Goyave, elle est en passe de mourir sur les murs de la vieille maison de gauche, mais elle refleurit déjà, peinte de frais, sur la toiture d’en face. Bientôt, l’antique maison sera démolie. La tôle ne supporte pas l’abandon. Comme les feuilles sèches du papayer dont elle partage les couleurs grises à rougeâtres, elle fane vite. Entretenue, elle peut durer un petit siècle et vieillira mieux que le monument aux morts qui, avec son béton peint en blanc, veut se croire en Ille-et-Vilaine et connaitra à ses dépens la houle salée du cul de sac marin.
Tôles légères ajustées en millefeuille tâché, comme passé au roucou, vous n’avez pas la rectitude du drapeau dressé sur son mât au milieu d’un parterre d’hibiscus soumis à la tonte sévère et administrative. Vous qui formez l’ossature quotidienne de l’habitat guadeloupéen, disparaitrezvous comme avant vous les cloisons de gaulette, le bois tressé et les torchis passés à la chaux ? Ou un architecte bienveillant saura-t-il mettre en valeur votre beauté âpre, adoubée par le temps et les usages ?
Estelle-Sarah BULLE,
juillet 2020
 Née en 1974 à Créteil (Val de Marne) d’une mère franco-belge et d’un père guadeloupéen, Estelle-Sarah Bulle est une écrivaine qui fait du métissage une des matières premières de son écriture.
Née en 1974 à Créteil (Val de Marne) d’une mère franco-belge et d’un père guadeloupéen, Estelle-Sarah Bulle est une écrivaine qui fait du métissage une des matières premières de son écriture.
Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue (Editions Liana Levi), retrace, à travers une épopée familiale, l’histoire contemporaine des populations françaises issues des Antilles et leur relation à la France hexagonale. Couronné de nombreux prix (Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, prix Eugène Dabit, prix Stanislas, prix Libraires en Seine 2019, prix APTOM, etc.), le roman est en cours de traduction pour une sortie aux Etats-Unis prévue en 2021.
En 2020, Estelle-Sarah Bulle publie un roman jeunesse, Les fantômes d’Issa (éditions L’Ecole des loisirs). Elle est aussi l’autrice de diverses nouvelles parues ou à paraître (notamment chez Caraibéditions ou dans le magazine Zadig).
Elle est en cours d’écriture de son second roman de littérature générale qui paraitra également aux éditions Liana Levi.