Point de vue n° 017
Goyave, Place du Monument aux morts, Rue Edouard Zora (97128)

Date : 05/07/2016 à 09:31 - Campagne initiale
Auteur : Sylvain DUFFARD
16.1362 ° Nord
-61.5738 ° Ouest
Canon EOS 5D Mark III
Canon 24-70mm f/2.8 série L II USM
35
400
800
11
143

Date : 11/07/2018 à 09:45 - Campagne de reconduction complète
Auteur : Sylvain DUFFARD
16.1362 ° Nord
-61.5738 ° Ouest
Canon EOS 5D Mark III
Canon 24-70mm f/2.8 série L II USM
35
400
500
11
143

Date : 06/07/2021 à 10:23 - Campagne de reconduction complète
Auteur : Sylvain DUFFARD
16.1362 ° Nord
-61.5738 ° Ouest
Fuji GFX 50R
GF 32-64mm F4 R LM WR
45
400
250
13
143
Mots clés
Unité paysagère
Vallons forestiers de Goyave
Typologies spatiales
Espaces urbains
Thématiques
Reconquête et dévitalisation des centres-bourgs, Équipements et espaces publics, Affichage publicitaire, signalétique, réseaux aériens
Intentions photographiques
Vestiges d'une architecture bois qui témoigne d'un autre temps et petit espace public aux couleurs de la patrie se font face de part et d'autre de la rue. Là aussi il est question de stratification paysagère.
(Sylvain DUFFARD, septembre 2016)
Analyse paysagère
Place du monument aux morts, Goyave
La Guadeloupe est un point sensible où l'on sent la Terre tourner. Le ciel y est en gestation. La matière de l'île, sulfureuse, ouatée de scories noires et rouges, éclot en permanence, mouillée puis remodelée. La mer a des bouillonnements laiteux, la falaise s'arase et les montagnes suent. Un perpétuel remuement de chaudron épuise l'herbe fragile et fait monter très vite les arbres jusqu'à leur point de rupture.
Et il y a les pentes difficiles de la Basse Terre, couvertes de tuf humide, où l'on ne s'accroche qu'à condition de faire preuve de légèreté et de connivence avec la nature. On les devine à l'arrière-plan de la photo ces degrés raides : collines parées d'arbres qui résistent en se renouvelant souvent plutôt qu'en misant sur une maturation lente, trop sujette aux dangereuses secousses et aux dévalements des eaux.
Pour habiter au milieu de cette instabilité, les Guadeloupéens ont dû prendre l'éphémère comme point de départ. Ils construisent dans l'urgence ce qui sera détruit demain, happent ce que les bateaux pressés charroient jusqu'à leurs rives déchiquetées, pensent abri plutôt que maison, contre les pluies lourdes et les tempêtes sablées.
Dans cette rue de Goyave, si semblable à d'autres ruelles fragiles de l'île, les matériaux s'étagent et se disloquent, comme le paysage. Le bitume se crevasse, la faïence écaille un trottoir patiné par les pas et la chaleur, la peinture se dissipe en lambeaux poudreux sur les arches de bois usées.
Et puis il y a la tôle. Rougie, onduleuse, dentelée par l'eau et le sel. Matériau du pauvre et de la hâte, elle est présente dans toute l'île.
Petite, je cohabitais avec les grandes plaques de tôle abandonnées sur le terrain de mon grand-père (on ne disait jamais "jardin"), à moitié recouvertes par la végétation, destinées à un hypothétique projet de "magasin" ou d'abri à cochon. Leurs bords écornés, rebiquant méchamment vers le ciel, restaient, même après des mois d'érosion, aussi coupants que la feuille de canne. Je me méfiais d'elles comme de caïmans à l'affût, prêts à mordre dans la chair tendre de mes mollets dénudés.
Un jour qu'au milieu des poules, je forçais à la fuite une mangouste au corps souple, ma mère m'appela depuis la terrasse de la maison. J'oubliai le danger de la tôle sous l'herbe brune et j'en fus punie. Mon pied transpercé poissa de sang ma sandale qui perdit définitivement sa couleur d'origine. Assise chancelante sur le bord de la terrasse, je n'osais pas regarder en face les lèvres obscènes de la blessure, couleur de litchi. J'envisageai tout de suite, le cœur battant, une maladie de rouille mortelle. On versa sur mon pied le rhum clair, bienfaisant. Je m'en tirai avec une simple entaille profonde.
Des semaines plus tard, après une nuit passée à écouter, recueillie, les coups de poing d'un robuste cyclone, j'ouvris la porte de mon grand-père sur un matin nouveau. Quelque chose avait changé autour de la maison. Les feuilles de tôles, qui semblaient enchâssées pour l'éternité dans la terre spongieuse, couvertes d'herbe à zébu et de manmzelle marie, avaient disparu. Levant les yeux, je les retrouvai hautes et nues dans le cocotier que le cyclone s'était amusé à garnir de ces papillotes métalliques.
La tôle, c'est aussi le toit des cases ; piano diabolique pour les doigts impérieux des pluies chaudes et félines. J'aimais l'écho assourdissant de ces rhapsodies folles au-dessus de ma tête. Une averse solide sur le toit interrompait toutes les conversations, étouffait les disputes les plus sonores, ramenait les voix de stentor au niveau d'un bêlement de cabri nouveau-né. Le paysage, aperçu depuis l'intérieur de la case restée ouverte, blanchissait jusqu'à disparaître derrière l'épais rideau de pluie. L'ondée musicienne s'en allait aussi rapidement qu'elle était venue. Le silence autour de la case ouverte revenait, perlé par les dernières notes sonores des gouttes dégringolant jusque dans les fûts de tôle qui servaient de citerne à côté de la cuisine. Sous ces lourds tonneaux cloutés prospéraient des dizaines de petites grenouilles siffleuses aux doigts délicatement lobés et des anolis pointus, d'un vert de tige fraîche.
Les jours de grande chaleur, petite vacancière désœuvrée, tandis que mon grand-père était aux champs, je passais l'après-midi, hébétée et rêveuse, à déchiffrer le craquement rythmé des murs et du toit de tôle, dilatés par le soleil.
Inventée en Allemagne, aussitôt adoptée par la pragmatique Angleterre, la tôle ondulée a vite conquis sa place dans les terres coloniales, de l'Australie à l'Afrique. Matériau pour populations soumises, pour habitats de misère dont les Gouvernements ne se soucient pas de la durée, elle a pourtant duré. La tôle s'est acclimatée partout, spécialement aux Caraïbes.
Dans cette rue de Goyave, elle est en passe de mourir sur les murs de la vieille maison de gauche, mais elle refleurit déjà, peinte de frais, sur la toiture d'en face. Bientôt, l'antique maison sera démolie. La tôle ne supporte pas l'abandon. Comme les feuilles sèches du papayer dont elle partage les couleurs grises à rougeâtres, elle fane vite. Entretenue, elle peut durer un petit siècle et vieillira mieux que le monument aux morts qui, avec son béton peint en blanc, veut se croire en Ille-et-Vilaine et connaitra à ses dépens la houle salée du cul de sac marin.
Tôles légères ajustées en millefeuille tâché, comme passé au roucou, vous n'avez pas la rectitude du drapeau dressé sur son mât au milieu d'un parterre d'hibiscus soumis à la tonte sévère et administrative. Vous qui formez l'ossature quotidienne de l'habitat guadeloupéen, disparaitrez vous comme avant vous les cloisons de gaulette, le bois tressé et les torchis passés à la chaux ? Ou un architecte bienveillant saura-t-il mettre en valeur votre beauté âpre, adoubée par le temps et les usages ?
Estelle-Sarah BULLE,
écrivaine
juin 2020
Passer par la production de prises de vue, acte par essence furtif, pour interroger le temps long du paysage, voilà pour ainsi dire résumé le dessein qui est celui du photographe qui intervient dans le cadre d’un observatoire. Dans le contexte guadeloupéen, je me suis attaché à photographier des portions d’espaces qui, une fois assemblées, constitueraient un portrait en creux de la Guadeloupe contemporaine. Étranger au territoire, l’ensemble photographique que j’ai produit entre 2016 et 2017, en dialogue avec la maîtrise d’ouvrage, est le fruit d’un patient travail de terrain, d’une démarche d’observation approfondie qui fait écho aux profonds bouleversements que la société guadeloupéenne a connus au cours du XXème siècle.
Il en est ainsi de ce point de vue réalisé à Goyave en juillet 2016 depuis la petite rue Edouard Zora, du nom des anciens propriétaires de la maison haute et basse, depuis longtemps abandonnée, qui occupe la partie gauche de l’image. Cette dernière donne à voir, de l’autre côté de la rue, une stèle dédiée aux soldats guadeloupéens « morts pour la France » en 1914-1918. La statue qui la surplombe semble considérer, par-delà la rue de la Liberté, la vieille bâtisse à l’agonie. Ainsi, comme en contrechamp de la vue photographique que j’ai produite, le monument commémoratif, guetteur solitaire, se fait le témoin des transformations paysagères à l’œuvre. Se jouent alors en miroir deux histoires mémorielles imbriquées : celle, mondiale, de la Grande Guerre et celle, créole, d’une architecture vernaculaire qui peu à peu s’efface des paysages de l’archipel.
Photographier le paysage permet de révéler un « état des choses », manière de renseigner l’observateur sur une « histoire des lieux ». Dans le cadre de l’observatoire, cette étude sensible se double d’une visée analytique et prospective. L’impératif chronophotographique, consubstantiel de la démarche, vient bien souvent influencer, si ce n’est conditionner, la réalisation des prises de vues initiales. Le choix du cadrage lui-même procède alors par anticipation des changements spatiaux susceptibles d’intervenir. J’ai opéré ainsi tantôt par hypothèse additionnelle, en laissant place à des portions d’espaces vacants (susceptibles de se remplir…), tantôt par hypothèse contraire en pariant sur de possibles évolutions par soustraction. C’est ainsi que ce point de vue de la rue Zora s’attache de façon centrale à une case en bois, relique recouverte d’une carapace de tôles aux nuances rouille, présence tout à la fois imposante et précaire, en même temps qu’il en anticipe la probable disparition ; une disparition effectivement survenue en 2018.
Sylvain DUFFARD,
photographe
juillet 2020
Les époques stratifiées dans les centres-bourgs
Les centres-bourgs sont de moins en moins habités au bénéfice des secteurs péri-urbains. A cela plusieurs raisons, réelles ou supposées : les vieilles maisons ne peuvent être mises au mode d’habiter actuel, l’indivision bloque souvent la transmission ou la vente, la densité est trop grande, la ville est trop bruyante… Certes, la réhabilitation de ces constructions laissées longtemps sans entretien est élevée voire très élevée mais toujours inférieure au coût sur la nature, les paysages, les linéaires de réseaux à créer et entretenir ou ceux toujours plus importants pour les transports scolaires et collectifs…
Pourtant, il serait pertinent que la puissance publique, les bailleurs et les investisseurs privés se réapproprient les centres anciens. Ces derniers bénéficient de bon nombre de commerces, services et équipements dans un périmètre proche, la solidarité et le lien social peuvent s’y développer, enfin ils sont desservis sans exception par les transports collectifs et les réseaux.
Aujourd’hui, les centres anciens se caractérisent par de nombreuses dents creuses et constructions à l’abandon qui entretiennent une image négative des bourgs. Il est temps de reconstruire la ville sur la ville, en passant du concept à la réalité opérationnelle.
Autre problème récurrent de nos centres-villes, c’est leur difficile accessibilité pour le piéton, a fortiori pour une personne à mobilité réduire. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les nombreuses ruptures de pente, les trottoirs non entretenus voire inexistants, les tampons, bouches à clé et autre mobilier urbain qui y sont implantés et les obstruent.
Jean Christophe ROBIN,
urbaniste
avril 2020
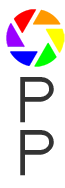

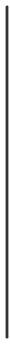







 Détails techniques
Détails techniques

